Cloud providers : vers une méthodologie commune pour réduire l’empreinte environnementale des services numériques ?
Retour et retranscription de nos réponses à la table ronde du GreenTech Forum 2025.
Par Benoit Petit
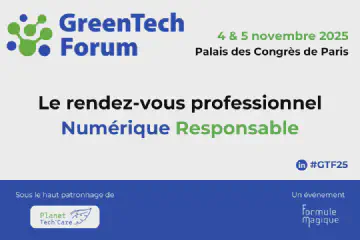
Benoit Petit d’Hubblo a participé à une table ronde sur la question des méthodes d’évaluation et d’affichage des impacts environnementaux des datacenters et des services Cloud lors du GreenTech Forum 2025, presque un an après la mise à jour du RCP Cloud & services d’hébergement de l’ADEME. Ses réponses lors de cette table ronde sont rassemblées ici, complétées et annotées à tête reposée pour permettre une compréhension plus fine et plus complète de cette thématique.
Les acteurs du cloud font face à une demande croissante pour mesurer et rendre transparent l’impact environnemental de leurs services numériques, d’où vient cet intérêt ? Est-ce que cela vient de la réglementation, une démarche volontaire des entreprises ?
Il y a plusieurs raisons selon moi :
Les datacenters sont remis au centre du débat public notamment du fait des volumétries qui s’envolent avec le techno-push de l’IA générative 1.
La réglementation évolue : la mise à jour de l’Energy Efficiency Directive 2 est en train d’être retranscrite en droit français. A terme, elle contraindra les opérateurs de datacenters de plus de 500 kW à transmettre à une agence d’Etat leur consommation d’énergie, d’eau, ainsi que leurs indicateurs d’efficience (PUE, WUE, CUE, REF, ERF, etc.) et d’autres indicateurs techniques et de volumétrie.
La démarche volontaire est là également, mais de manière assez évidente, lorsque l’on regarde les rapports annuels des grands acteurs de la tech, elle ne mène pas à une évolution aussi effective que la réglementation 3.
D’un autre côté, le secteur se porte extrêmement bien vis-à-vis de la réglementation. En excluant l’EED, l’heure est plus à la déréglementation pour faciliter l’installation des datacenters, avec l’article 15 de loi de simplification de la vie des entreprises 4, mais aussi le programme de fast track, permettant à certains projets un accès accéléré au raccordement électrique avec RTE 5.
Quelles sont les méthodologies que vous utilisez pour évaluer l’empreinte environnementale de vos infrastructures ou celles de vos clients ? Est-ce qu’il s’agit d’analyse sur tout le cycle de vie ? Sur tous les indicateurs ou uniquement certains ?
Il faut rappeler que le Power Usage Effectiveness (PUE), le Water Usage Effectiveness (WUE) et le Carbon Usage Effectiveness (CUE) ne sont que des indicateurs d’efficience.
Le PUE par exemple, est une fraction dont le dénominateur est la consommation d’énergie IT. Donc par définition, on peut consommer plus d’énergie via ses équipements IT et avoir un meilleur PUE. 6
Au-delà de ces indicateurs, utiles pour certains calculs mais bien différents des indicateurs environnementaux, chez Hubblo, nous nous concentrons surtout sur l’empreinte environnementale de l’ensemble du cycle de vie des infrastructures, produits et services, en s’appuyant sur l’Analyse de Cycle de Vie 7. C’est une méthode normée qui demande de comptabiliser l’empreinte, depuis l’extraction des minéraux, en passant par la fabrication, le transport, l’usage, jusqu’à la fin de vie. C’est également une approche multi-critère avec laquelle il est possible d’évaluer jusqu’à 16 critères environnementaux : potentiel de réchauffement global, consommation d’eau, occupation des sols, épuisement des minéraux et métaux, etc. 8
Pour être plus complet, nous nous intéressons également aux impacts indirects des infrastructures et services, en nous appuyant sur l’Analyse de Cycle de Vie Conséquentielle (ACV-c) 9. C’est-à-dire que l’on schématise les conséquences positives et négatives de la mise en place d’un service, vis-à-vis de l’environnement, afin de comprendre les dynamiques en jeu et parfois de calculer les impacts nets.
Enfin, notre ambition n’est pas une évaluation pour des chiffres ou des constats couchés dans un rapport qui ne servirait qu’à la communication. Notre but est surtout que cela permette d’éclairer des décisions visant la transformation socio-écologique des organisations.
Un enjeu sur l’évaluation de l’impact environnemental du cloud est la comparabilité. Etant donné que les cloud providers n’utilisent pas forcément les mêmes méthodes, cela rend difficile la comparaison. Ces méthodes ne comptabilisent pas les impacts de la même façon (approche géographique/marché, garanties d’origine, etc.), pouvez-vous nous expliquer quelques-unes de ces problématiques ?
Un exemple emblématique est celui des émissions liées à l’électricité consommée. Une grande partie des données qui alimentent le débat public se basent encore sur des données avec une point de vue market-based, c’est-à-dire qui prennent en compte les certificats de garantie d’origine (GO, REC ou PPA) dans le calcul d’empreinte. Ces certificats sont la raison pour laquelle les fournisseurs d’infrastructure affichent toujours que l’électricité consommée est issue à 100% d’électricité produite avec les ENR, ce qui est bien sûr physiquement totalement faux 10.
Sur ce sujet, même le GHG Protocol a lancé des groupes de travail pour que la norme évolue. Un de ces groupes travaille sur le changement du statut des certificats de garantie d’origine dans la méthode : à savoir ne plus les compter et privilégier un affichage de l’empreinte de l’électricité avec un point de vue location-based (basé sur le mix de production réel de la grille électrique concernée) 11. Des acteurs s’y opposent encore mais je pense que c’est une très bonne chose que les méthodes convergent au moins sur ce point. Le RCP Cloud & Datacenters de l’ADEME exclut du calcul les PPAs, à l’exception de ceux qui concernent les moyens de production ENR installés sur site, alimentant directement le datacenter. Je pense que ça va dans la bonne direction.
Au-delà de connaître son impact, l’évaluation permet également de mettre en avant les leviers pour écoconcevoir un service cloud. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d’écoconception ?
Celui qui devient capital mais que la majorité du secteur n’applique pas, c’est de revenir au premier pilier de l’écoconception qui consiste à questionner le besoin et la manière la plus sobre d’y répondre (ou choisir de ne pas y répondre). Parmi les GAFAMs, plusieurs affichent une augmentation à deux chiffres de leur empreinte carbone sur les dernières années, principalement du fait du béton dû à la construction des nouveaux bâtiments 12 13.
La fabrication des datacenters à l’échelle mondiale est en train de redresser le secteur de la construction 14.
Avec l’IA générative, l’impact de l’usage et de la consommation d’énergie revient au centre de l’équation : questionnement sur les usages et les choix technologiques pour répondre réellement au besoin. Je pense qu’on a toutes et tous dans la salle des clients ou partenaires qui utilisent des LLMs parce que c’est la tendance, alors qu’une étude du besoin montrerait en 10 secondes que ce n’est pas un choix efficient. Et en même temps, il s’agit d’un techno-push, ce qui dépasse la seule logique de l’offre et de la demande. Il y a des mécaniques économiques, marketing et politiques à l’œuvre pour que les organisations et les individus adoptent massivement l’IA générative, y compris pour les pires usages et les pires raisons.
En termes d’évaluation des impacts environnementaux, comment voyez-vous la suite ? Des demandes croissantes sur le sujet ? L’apparition d’une convergence des méthodes ?
Du point de vue de ce qui est en train d’arriver : une réglementation qui se structure en Europe, bien que lentement. Peu à peu, plus de visibilité sur le secteur. Une dérégulation déjà bien amorcée aux Etats-Unis en particulier 15.
J’espère que les discussions avec l’International Telecommunications Union vont aboutir, pour faire du RCP Cloud & Datacenters une norme mondiale concernant l’évaluation et l’affichage des impacts environnementaux du Cloud et de la colocation 16.
De manière plus systémique, j’espère une progression de la compréhension de ce sujet par les organisations et un regard critique plus acéré sur la manière dont le sujet est traité par les grands acteurs de l’infrastructure. On a parlé de normes et de réglementation aujourd’hui : le sujet progresse et tant mieux, mais il faut bien voir que pour le moment c’est le far west. On parlait d’auto-incitation du secteur, mais notons que le Climate Neutral Data Center Pact, groupement d’entreprises qui annoncent se saisir de ces sujets pour faire progresser le secteur, s’est prononcé contre la mise à jour de l’Energy Efficiency Directive, qui est la première bonne nouvelle significative d’un point de vue réglementaire depuis des années 17.
J’espère surtout une réglementation plus forte concernant la transparence et les pré-requis des nouvelles implantations de centres de données, mais il faut pour celà opérer un basculement politique. La bonne nouvelle c’est qu’il peut partir des entreprises pionnières sur le sujet, des dirigeant-e-s ou des employé-e-s qui sont aussi avant tout des citoyen-ne-s.
Analyse par la Quadrature du net, de l’Article 15 de la loi de simplification de la vie des entreprises ↩︎
Voir le Webinar d’Hubblo sur les référentiels, normes et indicateurs concernant les Datacenters ↩︎
Voir les normes ISO 14040 et 14044 et la norme ITU L.1410 pour l’application de l’ACV dans le numérique ↩︎
Les 16 critères environnementaux définis dans PEF (Product Environmental Footprint), la norme européenne sur le sujet ↩︎
Voir le position paper d’Etienne Lees-Perasso, qui résume brillament les problèmes liés aux certficats de garantie d’origine ↩︎
Lien vers les groupes de travail pour la mise à jour du GHG Protocol ↩︎
Article sur l’augmentation de l’empreinte carbone de Microsoft ↩︎
Article sur l’augmentation de l’empreinte carbone de Google ↩︎
Atrticle sur les datacenter et le secteur de la construction ↩︎
Dérégulation concernant l’installation des Datacenters aux USA ↩︎
Discussions menées en ce moment même pour faire du RCP une norme internationale ↩︎